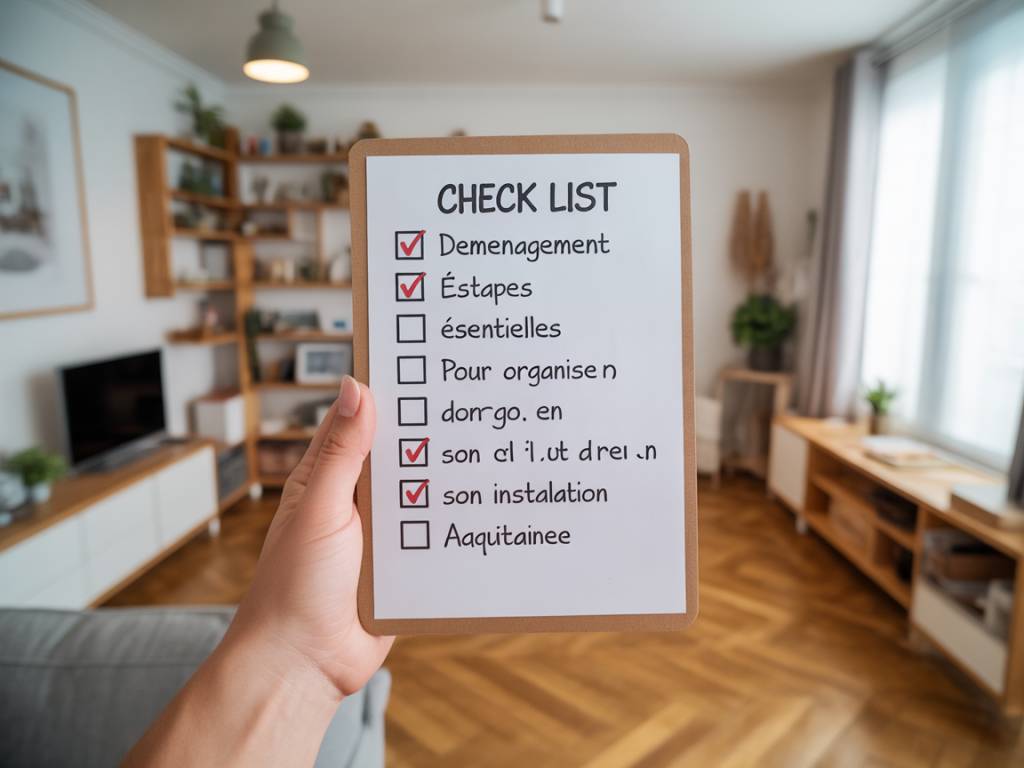Depuis le 1er octobre 2019, les collectivités territoriales ont une nouvelle ligne à ajouter à leur feuille de route énergétique : le respect du décret tertiaire. Ce texte, parfois méconnu hors des cercles techniques, impose aux bâtiments publics une transformation en profondeur. Objectif affiché : améliorer durablement la performance énergétique des bâtiments à usage tertiaire. Un défi de taille, mais aussi une opportunité.
Un décret aux allures d’injonction environnementale
Le décret tertiaire – ou plus précisément le décret n° 2019-771 relatif aux obligations d’actions de réduction de la consommation d’énergie dans les bâtiments à usage tertiaire – n’est pas un simple vœu pieux. Il est contraignant. À la clé : une réduction progressive de la consommation énergétique des bâtiments tertiaires de plus de 1 000 m². Et les bâtiments publics sont pleinement concernés.
Le calendrier est précis :
- -40 % d’ici 2030
- -50 % d’ici 2040
- -60 % d’ici 2050
Ces réductions s’appuient sur une année de référence comprise entre 2010 et 2019. Autrement dit, inutile d’espérer démarrer la course en 2024 avec de vieux compteurs : l’administration réclame des chiffres clairs, traçables, exploitables.
Et là où cela devient réellement contraignant, c’est qu’en cas de non-respect des obligations, les collectivités s’exposent à une sanction administrative, mais aussi à une mise en ligne publique de leur « non-exemplarité » sur la plateforme Operat. L’époque où l’on pouvait cacher un bâtiment mal isolé dans les bois semble révolue.
Les collectivités locales en première ligne
Écoles, gymnases, mairies, bibliothèques, centres techniques municipaux… tous ces équipements publics sont dans le viseur du décret. La mairie de Saint-Médard-en-Jalles, par exemple, a mené en 2023 un audit énergétique sur 17 de ses bâtiments. Résultat : 3 d’entre eux affichaient une consommation bien au-delà des seuils de conformité. Une alerte précieuse, mais coûteuse.
« Ce décret est une véritable révolution silencieuse dans la gestion du patrimoine communal », confiait récemment Michel Carde, directeur des services techniques d’une commune en Gironde. « Au-delà de la loi, c’est aussi une question de pédagogie auprès des équipes, des élus, et surtout des agents qui vivent ces bâtiments au quotidien. »
Le premier défi pour les collectivités reste donc l’inventaire. Il s’agit de recenser tous les bâtiments soumis au décret, d’évaluer leur consommation de référence, et de déclarer ces données sur la plateforme OPERAT, gérée par l’ADEME. Le délai de dépôt pour l’année de référence ayant été repoussé plusieurs fois, il reste néanmoins impératif de s’y atteler rapidement.
Des obligations, mais aussi des leviers d’action
Face aux coupes budgétaires et à la flambée des coûts de l’énergie, réduire les consommations devient une stratégie autant économique qu’écologique. C’est là que le décret peut devenir un allié. Car au-delà de l’injonction, il offre aussi une voie méthodique pour repenser la gestion énergétique.
Comment faire baisser la consommation ? Le texte reste volontairement flexible sur les moyens. Il ne prescrit pas de technologie ni de méthode, mais laisse la main aux acteurs de terrain. Il est possible d’agir sur plusieurs leviers :
- Optimisation des systèmes de chauffage, ventilation et climatisation (CVC)
- Isolation thermique du bâti
- Gestion intelligente de l’éclairage
- Changements d’usages et sensibilisation des usagers
Un bon exemple est celui de la communauté de communes du Val de l’Eyre. En 2022, elle a décidé d’installer des régulateurs thermostatiques dans plusieurs groupes scolaires. Résultat : une baisse de consommation de près de 12 % en un an, pour un investissement modeste.
Par ailleurs, l’achat d’énergie peut aussi être optimisé. Les groupements d’achat d’énergie ou la mutualisation à l’échelle départementale ou régionale permettent d’accéder à de meilleurs tarifs – une bouffée d’oxygène pour de nombreuses petites communes. Encore faut-il anticiper.
OPÉRAT : le pivot de la transparence
OPERAT n’est pas seulement une plateforme de déclaration. C’est désormais l’outil pivot de suivi des obligations du décret tertiaire. Chaque collectivité doit y déclarer annuellement les consommations énergétiques de ses bâtiments assujettis, les comparer à leur consommation de référence, et mettre à jour les actions mises en place.
Mais attention : les données doivent être transmises dans les temps (jusqu’au 31 décembre pour chaque exercice) et dans un format conforme. L’ADEME fournit des modèles de fichiers et des guides, mais l’opération reste chronophage, notamment pour les petites structures peu équipées en ingénierie technique.
La mutualisation des moyens, via les syndicats d’énergie ou les agences locales, est souvent nécessaire. En Nouvelle-Aquitaine, l’agence ALTEAQ propose par exemple un accompagnement dédié aux collectivités et publie régulièrement des fiches pratiques. Même si cela ne rendra pas l’interface d’OPERAT plus intuitive, cela facilite le passage à l’action.
Obstacles sur la route : technicité et écarts de moyens
Le décret tertiaire met également en lumière une inégalité criante entre les collectivités. Là où une métropole peut mobiliser des ingénieurs, acheter des outils de monitoring, ou contractualiser des prestations de suivi énergétique à l’année, une commune rurale devra souvent se débrouiller seule. Les solutions existent, mais leur accès reste inégal.
« On s’est retrouvés désemparés », explique Jean-Michel, maire d’une petite commune du Lot-et-Garonne. « On n’a pas les compétences en interne, pas de budget pour embaucher un bureau d’études, et on n’a pas besoin tous les ans. Et pourtant, on doit faire comme Bordeaux. »
Des appels à projets sont parfois lancés par les Régions ou les Départements pour accompagner les collectivités à être en conformité. Encore faut-il être au courant. Là aussi, le besoin d’information est permanent.
Et sur le terrain, comment ça se passe ?
À Bergerac, la rénovation thermique du centre administratif intercommunal a permis de passer d’une passoire énergétique classée E à une étiquette B. Les travaux ont duré huit mois, et ont intégré l’élargissement des vitrages, la refonte complète du système de chauffage, et l’installation de capteurs pour suivre en temps réel les consommations. Un financement croisé entre l’ADEME, la Région Nouvelle-Aquitaine et la collectivité a permis de boucler le montage.
Certes, tout le monde ne peut pas investir plusieurs centaines de milliers d’euros. Mais d’autres choix existent. À Lormont, c’est une campagne de sensibilisation visant les élèves et le personnel dans les écoles qui a permis de réduire de 7 % les consommations en un an, simplement en modifiant certaines habitudes (fermer les portes, baisser le chauffage la nuit, couper les veilles électriques).
Autrement dit, pas besoin de tout casser pour être efficace. Mais il faut s’emparer du sujet.
Une contrainte qui masque un changement de culture
Au fond, le décret tertiaire est moins un texte technique qu’une invitation – pressante – à revoir notre manière d’habiter, d’exploiter et de concevoir les bâtiments publics. Il interpelle sur la notion d’exemplarité, chère aux politiques publiques. Car comment sensibiliser les citoyens aux écogestes, aux économies d’énergie, si la commune ne montre pas l’exemple ?
Cette exigence n’est pas seulement symbolique. Les bâtiments publics, ouverts au public, concentrent une large partie des usages quotidiens : éducation, sport, administration… Ils sont donc à la fois lieux de service et vitrines de l’action publique. L’enjeu devient alors pédagogique, presque culturel.
Si certains élus regrettent la surcharge réglementaire, beaucoup reconnaissent que cette obligation a au moins un mérite : elle pousse à agir, à structurer une politique énergétique locale, et à se poser les bonnes questions. Même si elles dérangent.
Et si cette transition énergétique un peu forcée devenait une opportunité d’innovation territoriale ?
La question mérite d’être posée.